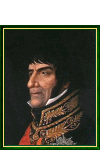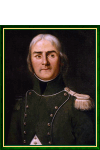Duc de Dantzig (ou Dantzick)
Prononciation :
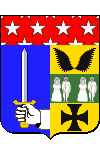
Cet Alsacien (il est venu au monde le 25 octobre 1755 à Rouffach), orphelin à huit ans, est élevé par un oncle qui, prêtre lui-même, souhaite le faire entrer au séminaire. Mais le jeune François Joseph Lefebvre préfère la carrière militaire et obtient de son tuteur la permission de s'engager, en 1773, comme soldat aux gardes françaises.
Sergent en 1788, il sauve la vie de plusieurs de ses officiers le 14 juillet 1789.
Promu lieutenant instructeur dans la garde nationale, il manifeste par ses actes une remarquable loyauté à la cause monarchique. Ainsi est-il blessé en protégeant la rentrée de la famille royale après la tentative d'évasion de Saint-Cloud (18 avril 1791), avant de favoriser la fuite des tantes de Louis XVI.
Passé dans un régiment de ligne avec le grade de capitaine à la déclaration de guerre, en 1792, il est général de brigade à la fin de 1793, de division en janvier 1794. Employé aux armées du Rhin et de la Moselle, il sert successivement sous Louis Lazare Hoche (dont il avait été l'instructeur aux gardes françaises), Jean-Baptiste Jourdan et Jean-Baptiste Kléber.
Entre 1793 et 1799, il est de toutes les batailles : Geisberg (26 décembre 1793), prises d'Arlon (18 avril 1794) et de Dinant (29 mai), Fleurus (26 juin), Altenkirchen (4 juin 1795), Wetzlar (15 juin), Friedberg (10 juillet), passage du Rhin à Neuwied (18 avril 1797). Il devient à cette occasion le premier général de la République à s'établir sur la rive droite du Rhin.
Grièvement blessé à Pfullendorf, le 21 mars 1799, il doit quitter le front.
Le Directoire, après son rétablissement, le nomme commandant de la 17ème région militaire, dont Paris est le quartier général. Fort lié à Bernadotte et Jourdan, il est alors considéré comme un fervent républicain. Il a d'ailleurs peu auparavant été désigné comme candidat au poste de Directeur par le Conseil des Cinq-Cents, mais sans être choisi par les Anciens.
Il se laisse pourtant séduire par Napoléon Bonaparte et lui apporte son soutien. Les 18 et 19 brumaire, il joue un rôle primordial dans le coup d'État. C'est lui qui donne l'ordre à Charles Victor Emmanuel Leclerc de faire évacuer la salle des Cinq-Cents, assurant le succès d'une opération mal engagée.
Napoléon Bonaparte, qui n'oubliera pas ce qu'il lui doit, le fait sénateur en décembre 1799 et lui donne le titre de maréchal en 1804 (tout comme à trois autres sénateurs : Kellermann, Pérignon et Sérurier, et par contraste avec les quatorze maréchalats de plein exercice octroyés à des généraux en activité). Cependant, ayant probablement quelques doutes quant aux capacités militaires de Lefebvre, en qui il voit surtout un excellent instructeur, l'Empereur le tient éloigné des champs de bataille jusqu'en 1806.
La campagne d'Allemagne voit son retour sur le terrain. Après s'être battu à Iéna, il reçoit la mission de prendre Dantzig. On l'entoure à cet effet de collaborateurs de qualité qui prendront une part déterminante au succès : Jean-Baptiste Drouet d'Erlon dirige son état-major, François de Chasseloup-Laubat les travaux du siège, François Joseph Kirgener commande le génie, Jean Ambroise Baston de Lariboisière l'artillerie. L'armée, en revanche, est un mélange de troupes françaises, polonaises, saxonnes et badoises peu combatives et difficiles à conduire.
Lefebvre s'y emploie avec, selon les témoins, une activité prodigieuse : Foutez-moi un trou et j'y passerai
, se trouvant continuellement au milieu de ses soldats, et toujours là où il y a le plus de danger. Le siège se prolonge du 12 mars au 24 mai 1807. La place capitule enfin peu après que les divisions du maréchal Mortier sont venues renforcer les assaillants.
Pour ce haut fait, Lefebvre reçoit en mains propres de l'Empereur « une livre de chocolat » (le paquet contient en fait trois cent mille francs !) et devient, dès le 27 mai 1807, le premier duc créé par Napoléon Ier.
Le duc de Dantzig (ou Dantzick, comme il l'orthographie lui-même) ne quitte pas ses bottes pour autant : peu après, il est envoyé en Espagne, où il sert de septembre à décembre 1808. Vainqueur à Durango le 31 octobre, il prend Bilbao, Santander, bat les Anglais à Guenes (7 novembre), Valmaceda (8 novembre) et s'empare de Ségovie (3 décembre).
Il reprend ensuite le chemin de l'Allemagne pour commander les troupes bavaroises avant d'être chargé de réprimer l'insurrection du Tyrol menée par l'aubergiste patriote Andreas Hoffer. Battu à Steinach (11 août 1809), il ne peut en venir à bout.
Il ne retrouve de commandement qu'en 1812, où lui est confié celui de la Vieille Garde lors de la campagne de Russie. Il a peu d'occasions de combattre à la tête de cette unité particulièrement ménagée par Napoléon Ier. Mais il force l'admiration au cours de la retraite en marchant à pied au milieu de ses soldats, malgré ses presque soixante ans et ses infirmités. Il se laisse aussi aller pour la première fois à des critiques contre l'entourage de l'Empereur : Un tas de bougres qui ne lui disent pas la vérité.
Épuisé moralement et physiquement, il ne prend aucune part aux opérations en 1813 mais il est rappelé une dernière fois pour la campagne de France de 1814 par un Napoléon Ier à bout de ressources. Il commande à nouveau la Vieille Garde pour une vingtaine de jours, se montre à Champaubert (10 février 1814) et Montmirail (11 février) et livre sa dernière bataille à Montereau le 18 février.
Le 2 avril 1814, il vote la déchéance de l'Empereur au sénat. Le 4, il assiste à la scène au cours de laquelle Macdonald obtient de Napoléon 1er son abdication. Le 24, avec huit autres maréchaux (Berthier, Brune, Macdonald, Marmont, Moncey, Mortier, Ney, Soult), il présente ses hommages à Louis XVIII. Celui-ci le fait pair de France.
Le duc de Dantzig consacre les dernières années de sa vie à la commune de Combault, dont il est maire depuis 1813, et où il possède un château
Il succombe à une hydropisie de poitrine le 14 septembre 1820 à son hôtel parisien de la rue Joubert. Sa magnifique tombe
"Le maréchal Lefebvre, duc de Dantzick" peint en 1807 par Césarine Davin née Mirvault (Paris 1773 - Paris 1844).

Lorsque le couple Lefebvre se présentait à la Cour, Napoléon 1er s'agaçait de la rudesse des manières du maréchal et du peu de distinction de sa femme, la célèbre Madame Sans-gêne, ex-lavandière. Le maréchal, cependant, aussi mal dégrossi fût-il, savait fort bien se défendre contre ceux dont toute l'illustration tenait dans une noblesse immémoriale. Comme l'un d'eux, un jour, se targuait devant lui de l'ancienneté de sa lignée, il eut ce mot fameux : Eh ! ne soyez pas si fier. Moi ! je suis un ancêtre !
Le nom de Lefebvre est inscrit sur la 3e colonne (pilier Nord) de l'arc de triomphe de l'Étoile
Carrière militaire détaillée
établie par M. Eric Le Maître (voir son site web), mise en ligne avec son aimable autorisation.Blessures au combat
Par une balle au bras gauche à Pfullendorf, le 21 mars 1799.Captivité
Aucune.Premier engagement
Comme soldat au régiment des gardes françaises, le 10 septembre 1773.Évolution de carrière
Caporal, en 1777.Sergent, le 28 juin 1782.
Premier sergent, le 9 avril 1788.
Lieutenant instructeur, le 1er septembre 1789.
Capitaine, le 1er janvier 1792.
Adjudant général chef de bataillon, le 3 septembre 1793.
Général de brigade, le 2 décembre 1793.
Général de division, le 10 janvier 1794.
Maréchal de l'Empire, le 19 mai 1804.
États de service
Soldat au Régiment des gardes françaises, le 10 septembre 1773.Aux grenadiers, le 2 juin 1786.
A la garde nationale de Paris, le 1er septembre 1789.
Au 13e bataillon d'infanterie légère, le 1er janvier 1792.
A l'armée du Centre puis de la Moselle, 1792 et 1793.
A l'armée de la Moselle, le 2 décembre 1793.
A l'armée de Sambre-et-Meuse, le 28 juin 1794.
Commandant la 2e division, le 7 août 1794.
Commandant la 1ère division, le 25 décembre 1794.
Commandant l'avant-garde de l'armée, le 30 mars 1796.
Commandant la 1ère division et la droite de l'armée, le 23 janvier 1797.
Commandant provisoire de l'armée de Sambre-et-Meuse à la mort de Hoche, le 19 septembre 1797.
Nommé à l'armée d'Angleterre sous Kléber : Commandant la division d'avant-garde de l'armée de Mayence, le 14 décembre 1797.
Commandant le corps du Haut-Rhin, le 5 juin 1798.
Commandant par intérim l'armée de Mayence à la place de Joubert, du 8 au 25 octobre 1798.
Commandant la 6e division de l'armée de Mayence, le 21 novembre 1798.
Commandant la division d'avant-garde de l'armée du Danube, le 9 février 1799.
Revient à Paris et est désigné par le conseil des Cinq-Cents comme candidat à la place de Treilhard (n'est pas élu), le 11 mai 1799.
Commandant de la 17e division militaire à Paris, le 13 août 1799.
Prend une part importante à la journée du 18 Brumaire.
Commandant les 14e, 15e et 17e divisions militaires, en décembre 1799.
Sénateur, le 1er avril 1800.
Commandant le corps de Réserve réuni à Mayence, le 19 septembre 1805.
Commandant supérieur des bataillons de gardes nationales de la Roer, du Mont-Tonnerre et de Rhin-et-Moselle, le 30 septembre 1805.
Commandant le 5e corps de la Grande Armée, le 4 septembre 1806.
Commandant l'infanterie de la Garde Impériale, le 5 octobre 1806.
Sert en Prusse et en Pologne, en 1806 et en 1807.
Commandant le 10e corps de la Grande Armée et chargé du siège de Dantzig, le 23 janvier 1807.
Commandant le 4e corps de l'armée d'Espagne, du 7 septembre 1808 au 10 janvier 1809.
Commandant le 7e corps (Bavarois) de l'armée d'Allemagne, le 14 mars 1809.
Commandant l'armée du Tyrol, de mai à octobre 1809.
Commandant l'infanterie de la vieille garde en Russie, le 10 avril 1812.
Rappelé en France, le 11 janvier 1813.
Commandant la vieille garde en Champagne, le 8 février 1814.
Vote au Sénat la déchéance de Napoléon.
Pair de France à la Première Restauration, le 4 juin 1814.
Pair de France aux Cent-Jours, le 2 juin 1815.
De nouveau pair de France, le 5 mars 1819.