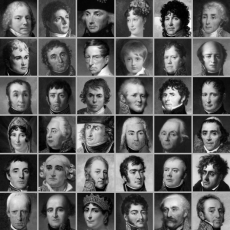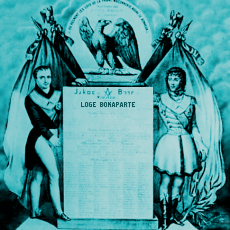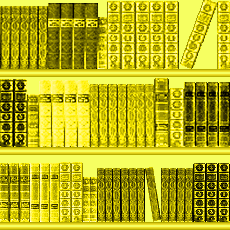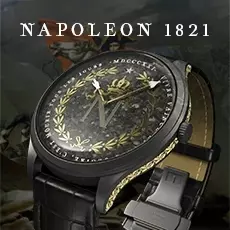Nouveautés
Les pages du site récemment ajoutées, complétées ou refonduesQuiz
Saurez-vous retrouver qui se cache derrière cette définition ? Attention, il y a peut-être un piègeBataille(s) du mois
21 octobre 1805 : Bataille de Trafalgar
La bataille navale de Trafalgar consacre le génie tactique du vice-amiral Horatio Nelson, qui dispose d'une flotte en infériorité numérique mais composée de navires de meilleure qualité et de marins mieux entraînés.
Trafalgar scelle la suprématie britannique sur les mers, qui va rester incontestée jusqu'à la Première Guerre mondiale.
14 octobre 1806 : Batailles d'Iéna et d'Auerstaedt
Ce jour-là, deux batailles jumelles opposent des fractions inégales des armées françaises et prussiennes. La Grande Armée s'impose au cours des deux confrontations, qu'elle soit en supériorité numérique avec Napoléon ou en nette infériorité avec Davout.
La prestigieuse armée prussienne, endormie dans le souvenir de Frédéric le grand, est totalement détruite. Davout réalise à cette occasion son plus brillant fait d'armes.
16 au 19 octobre 1813 : Bataille de Leipzig
La bataille de Leipzig, également appelée "bataille des Nations", la plus grande confrontation des guerres napoléoniennes, voit la Grande Armée (190 000 hommes, dont un corps de Saxons), sous le commandement de l'Empereur Napoléon Ier, affronter une coalition prusso-austro-russo-suédoise presque deux fois plus nombreuse (330 000 hommes), sous les ordres du général Gebhard Leberecht von Blücher, du prince Karl Philipp zu Schwarzenberg et de Jean-Baptiste Jules Bernadotte, prince héritier de Suède.
Les combats font rage durant trois jours aux alentours de Leipzig. La trahison des Saxons, en plein combat, le soir du 18 octobre, scelle le sort de la confrontation. Napoléon subit là sa plus grande défaite. Les pertes, énormes, sont estimées entre 80 000 et 110 000 morts ou blessés au total.
Événements du jour
22 octobre
1807
Conclusion d'une alliance secrète entre le Portugal et l'Angleterre.
1808
Un décret substitue la mention « Empire français » à « République française » sur les monnaies.
1812
Face à la résistance héroïque du général Dubreton et de ses 1 800 hommes, Wellington lève le siège de Burgos.
Photos du mois
22 octobre 1784 : Napoléon entre à l'École royale du Champ de Mars

14 octobre 1805 : Bataille d'Elchingen

23 octobre 1806 : Installation du commandement français au château de Charlottenbourg

La raison d'être du site Napoléon & Empire
Rechercher « Napoléon Bonaparte » sur Google, c’est se voir proposer plus d’une dizaine de millions de résultats. L’idée d’ajouter une goutte à cet océan ne peut par conséquent venir qu’aux passionnés, résolus qu’ils sont à témoigner de leur fascination pour un personnage doté, selon Chateaubriand, du « plus puissant souffle de vie qui jamais anima l’argile humaine ».
Le site « Napoléon & Empire » ne revendique nulle autre légitimité.
Napoléon, selon nous, par sa volonté, son intelligence, son audace et son oeuvre, représente le prototype du « grand homme ». Même si ce concept est aujourd’hui considéré avec méfiance, il n’en reste pas moins qu’issu d’une lignée relativement modeste et d’une province périphérique tout récemment réunie à la France — Chateaubriand qualifiera sa famille de « demi-africaine » —, il se hisse au pouvoir dans un des plus vieux et des plus importants pays d’Europe, avant de se tailler un empire sur ce continent alors constitué des nations les plus prospères, les plus développées et les plus puissantes du globe. Même César, patricien né dans la capitale de l’Empire romain, ou Alexandre, héritier du royaume de Macédoine, ne peuvent de ce point de vue lui être comparés. Cette vertigineuse ascension, il la doit à son talent, bien sûr, mais également à son énergie et surtout à son activité — toujours, il parlera de son génie d’un ton quelque peu narquois, mais s’enorgueillira hautement de sa capacité de travail. Son parcours s’avère par là positivement révolutionnaire.
Son œuvre l’est tout autant. La période qui vit se dérouler la carrière de Napoléon, en vérité si courte, abonde à tel point en événements qu’elle n’a pas d’équivalent dans notre histoire. Il revint au Premier consul puis à l’Empereur de présider à la reconstruction, sur les ruines de l’Ancien Régime détruit par la Révolution, d’une société nouvelle appuyée sur de nouvelles règles juridiques, politiques et sociales. Moins éclatante que les prouesses militaires, cette refondation s’avéra plus utile et plus profitable à la nation — plus durable, également, dans ses effets, car l’édifice institutionnel qu’elle bâtit se montra d’une rare solidité et se maintint pour l’essentiel jusqu’au XXe siècle. La France érigea sur ce socle son état moderne, imitée en cela par nombre de pays européens.
Pourquoi, avec un pareil bilan, Napoléon suscite-t-il, à côté de tant d’admiration et de fascination chez certains, une telle hostilité chez d’autres ? Pourquoi les autorités françaises ont-elles préféré rester d’une discrétion de majordome anglais durant les années 1996-2015, alors que tant de bicentenaires glorieux ne demandaient qu’à être commémorés ? Le procès en rétablissement de l’esclavage qui a été intenté à Napoléon ne peut expliquer à lui seul ce phénomène, d’autant qu’il ne débuta qu’en 2005, et que d’autres occasions avaient déjà été gâchées dans les années précédentes.
La cause première tient certainement à la réputation de bellicisme qui s’attache à son nom et aux hécatombes dont on lui fait porter la responsabilité. Mais est-il bien le seul à blâmer pour les conflits incessants qui ont ravagé l’Europe pendant son règne ? N’y a-t-il aucun doute sur la volonté de paix de ses adversaires, et tout particulièrement de l’Angleterre, qui financera vingt-cinq ans durant les hostilités contre la France, son principal rival historique ? Alors certes, celui que beaucoup considèrent comme le plus grand génie militaire de tous les temps et qui en imposa toujours à ses ennemis sur le champ de bataille a pu abuser de cette supériorité. Il est cependant difficile de nier que ses entreprises guerrières aient poursuivi des buts autres que politiques. C’est Louis XIV qui avoue : j’ai trop aimé la guerre ; Napoléon, lui, s’en sert comme d’un outil et ne prolonge jamais les hostilités une fois ses objectifs atteints. Il est vrai que, jusqu’à ce moment, il la pratique sans états d’âme. Si le temps et l’évolution des mentalités ont gâté le prestige des grands conquérants, rappelons-nous cependant que Napoléon vivait à une époque où gloire militaire et héroïsme étaient ordinairement classés parmi les plus nobles accomplissements de la personne humaine et la guerre tenue pour une école de vertu. Il ne faut d’ailleurs pas retourner très loin en arrière pour retrouver le temps où les Hoche, Marceau, Kléber et Desaix étaient proposés en exemple aux enfants.
Le général Bonaparte, affirment certains, fut certes de la même trempe. Mais il ne mourut pas comme eux au tournant du siècle et se métamorphosa en un personnage tout différent : Napoléon Ier. C’est l’autre reproche récurrent qui lui est adressé : avoir étouffé la Révolution. C’est oublier — ou refuser de voir — que son régime se montrait le digne héritier de celle-ci lorsqu’il s’épuisait à en faire admettre les annexions par les souverains européens ; que l’Empire, en tant qu’entité politique, participait à la fois de la monarchie et de la république ; que les guerres qu’on dit napoléoniennes, si décriées, ont également entraîné l’effondrement de larges pans des institutions féodales et absolutistes à travers toute l’Europe ; que l’Empereur resta constamment plus populaire dans les classes inférieures de la société que dans les supérieures ; qu’il s’est toujours montré soucieux de fournir du travail aux ouvriers et d’approvisionner correctement les marchés !
Tout ceci, objectera-t-on, au prix de la liberté. C’est vrai. Il est impossible de le nier. Le tempérament, la formation reçue, se conjuguaient, chez Napoléon, pour lui faire haïr le désordre. Or il voyait en lui la conséquence d’une excessive liberté durant les années révolutionnaires. Il s’en méfia donc et la comprima de toutes ses forces. Ce faisant, toutefois, il ne rencontra qu’une faible opposition dans la société française, car celle-ci manifesta pour cette perte une indifférence assez générale dès lors que l’égalité, elle, était proclamée et assurée, tandis que l’éclatante grandeur de la Nation, qui approchait de fort près la domination totale de l’Europe, flattait l’orgueil de sa population. Le sacrifice consenti était, semblait-il, largement compensé. Et peut-être constituait-il la condition pour aboutir à cette synthèse de la France d’Ancien Régime et de la France Révolutionnaire qui fut, dès après le 18 brumaire, un des objectifs les plus opiniâtrement poursuivis par le consul Bonaparte comme par l’Empereur Napoléon. S’il ne l’atteignit pas, faute de temps, et si les élites respectives de ces deux groupes ne s’amalgamèrent pas, il les obligea néanmoins, tout au long de son règne, à coexister et à mettre leurs capacités au service de l’état, pour le plus grand bénéfice de celui-ci. Le Consulat et l’Empire composent en effet ensemble l’une de ces rares périodes de l’histoire de France où les succès de notre pays étaient acquis exclusivement aux dépens de puissances étrangères, et non d’une partie de son propre peuple.
Force est donc de constater que le personnage apparaît si divers que tout jugement le concernant s’avère nécessairement réducteur. D’où les témoignages contradictoires qu’il suscita tout au long même de sa vie et les appréciations si divergentes portées sur sa personne ou son œuvre. Comment trouver la case où ranger ensemble un jeune patriote corse, un souverain déchu, prisonnier et malade, un conquérant victorieux, un général révolutionnaire prisé des Robespierre puis de Barras, un empereur autoritaire ? Napoléon endossa pourtant tous ces rôles et bien d’autres encore, dans les sphères diplomatiques, politiques, administratives autant que guerrières. À lui seul, il est l’exception qui confirme — ou l’exemple qui invalide, chacun en jugera d’après sa conviction personnelle — la conception selon laquelle l’histoire s’explique par les lois générales de l’évolution des sociétés et non par les conséquences des choix de ses grands acteurs.
Pour conclure, nous affirmons que la vie de Napoléon Bonaparte représente l’un des plus prodigieux phénomènes de l’histoire, qu’il en est un de ses personnages les plus irréductiblement singuliers et pourtant les plus universels. Sa complexité fascine toujours, et dans le monde entier. Chaque génération trouve en lui de quoi alimenter ses propres problématiques. Nul doute que reste encore lointain le jour où son histoire cessera de s’écrire.
Lionel A. Bouchon